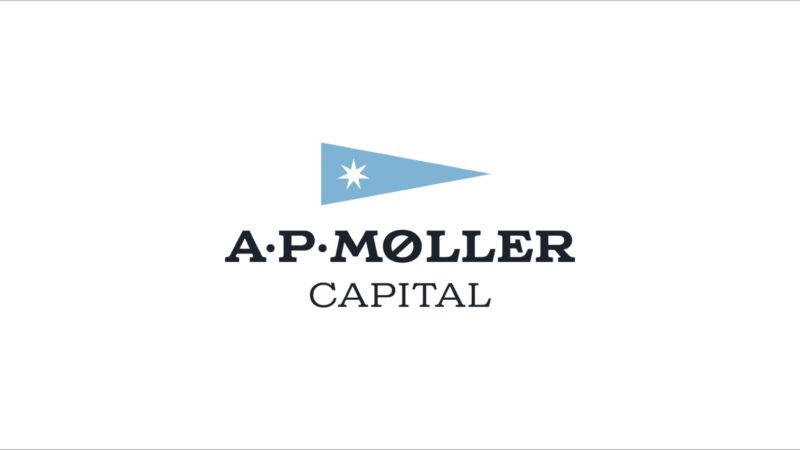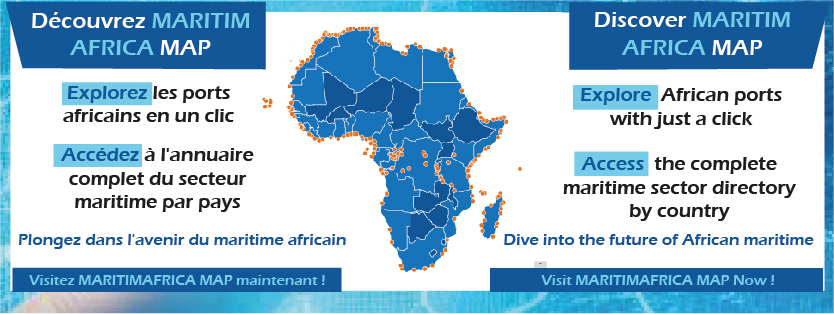Pourquoi l’Afrique est-elle absente de la carte du pouvoir maritime ?

Sans doctrine maritime propre, l’Afrique risque de perdre progressivement sa souveraineté sur ses mers
Abdisaid M. Ali, The East African
Lors d’un récent débat de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations unies, des dirigeants mondiaux se sont réunis pour affronter une vérité désormais incontestable : l’espace maritime n’est plus seulement un lieu de commerce. Il est devenu un théâtre de compétition géopolitique, d’infrastructures numériques et de menaces hybrides.
Le ton était urgent. Le consensus, clair : la liberté de navigation, la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales et la surveillance du domaine maritime ont été soulignées comme des priorités pour la paix internationale et la résilience économique.
Pourtant, à mesure que les déclarations se succédaient dans l’enceinte — certaines audacieuses, d’autres tactiques, beaucoup affirmées — une réalité devenait évidente : l’Afrique restait une fois de plus en périphérie d’une conversation qui aurait dû la placer au centre.
Ce n’est pas une tendance nouvelle. C’est un angle mort familier, et de plus en plus dangereux.
Les océans entourant l’Afrique couvrent environ 214 millions de kilomètres carrés. Avec 90 % de notre commerce qui transite par voie maritime, la question n’est plus de savoir si les mers comptent, mais si nous contrôlons certains des couloirs maritimes les plus stratégiques de l’ordre mondial — tels que le Bab el-Mandeb, le golfe de Guinée, le canal du Mozambique ou la mer Rouge. Ce ne sont pas des routes périphériques.
Ce sont des artères vitales du commerce mondial, des leviers de sécurité et des portes d’entrée vers l’avenir économique du continent. L’Union africaine dispose déjà d’un cadre juridiquement contraignant — la Charte de Lomé, officiellement appelée Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement en Afrique — conçu pour protéger cet espace maritime.
Mais l’écart entre ce cadre juridique et sa mise en œuvre réelle demeure dangereusement large. À moins que l’Afrique ne passe de la ratification à une véritable maîtrise opérationnelle, cette Charte restera une promesse non tenue, tandis que des acteurs étrangers consolideront leur emprise sur nos zones côtières.
Dans les débats maritimes mondiaux, l’Afrique est encore perçue non comme un acteur souverain, mais comme une vulnérabilité à gérer. Alors que d’autres États dévoilent des stratégies maritimes nationales, négocient des accès portuaires et renforcent leurs capacités navales hauturières, l’Afrique est souvent évoquée en termes d’aide, de renforcement des capacités et de coopération technique.
Ce cadrage n’est plus acceptable. Il n’est pas seulement inexact, il est stratégiquement imprudent.
Le récent débat au Conseil de sécurité des Nations unies a mis en évidence une prise de conscience croissante chez les grandes puissances : l’espace maritime est en passe de devenir le prochain front de rivalités et de réalignements. De la pêche illégale aux flottes fantômes, des câbles sous-marins aux ports à double usage, les menaces et opportunités maritimes se multiplient.
On s’est largement accordé sur le principe que la sécurité maritime est un fondement de la stabilité mondiale. Ce qui a toutefois été peu exprimé, c’est que cette stabilité repose en grande partie sur les eaux africaines — et pourtant, les États africains ne fixent ni l’agenda ni les cadres régissant la gestion de leurs zones maritimes.
Ce n’est pas une simple omission diplomatique. C’est une vulnérabilité structurelle.
L’espace maritime africain devient une zone contestée d’influence, d’infrastructures, de surveillance et de souveraineté. Les exercices navals étrangers se multiplient le long de nos côtes. Des ports en eaux profondes sont construits ou réaménagés sans transparence. Des contrats d’exploration des fonds marins sont signés sans supervision continentale solide. Les capacités de renseignement et de surveillance s’étendent souvent en dehors de tout contrôle de nos institutions réglementaires.
Ce n’est pas un partenariat. C’est une pénétration stratégique, dissimulée derrière le langage de la coopération.
Si l’Afrique ne définit pas une doctrine maritime propre, si elle ne prend pas le contrôle de ses routes maritimes, de ses ports et de ses infrastructures côtières, elle se retrouvera piégée dans un avenir où sa souveraineté sera progressivement diluée.
Cette érosion ne viendra pas sous la forme d’une invasion. Elle se fera par des contrats discrets, des accords fragmentés, et l’absence d’une réponse continentale unifiée.
Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce ne sont pas des discours, mais un réajustement stratégique.
L’Union africaine doit aller au-delà des déclarations symboliques et opérationnaliser la Stratégie africaine intégrée pour les mers à l’horizon 2050 (AIMS 2050). Les institutions régionales doivent prendre l’initiative de coordonner les cadres juridiques et sécuritaires pour aboutir à une position continentale unifiée sur l’accès aux ports, la coopération navale et le droit maritime.
Un organe continental permanent, indépendant, technocratique et doté d’un ancrage politique, doit être mis en place pour auditer toutes les infrastructures maritimes étrangères et les arrangements sécuritaires.
Nous avons besoin d’un Protocole continental contraignant sur la souveraineté maritime, adopté et respecté par les États membres, qui fixe des normes claires en matière de transparence, d’alignement stratégique et de réciprocité dans tous les accords maritimes avec des acteurs non africains. Les États membres doivent affirmer leur droit collectif à façonner les règles de gouvernance maritime, et non simplement se conformer à des cadres imposés de l’extérieur.
Dans ce contexte, l’article récemment publié par The EastAfrican, intitulé « Des pirates aux profits : l’Afrique de l’Est doit gouverner l’océan Indien », constitue une intervention stratégique et opportune. Il repositionne à juste titre l’océan Indien non comme une simple préoccupation sécuritaire, mais comme une zone de commandement économique, et appelle les nations d’Afrique de l’Est à prendre les devants au lieu d’observer passivement.
L’accent mis sur la coopération navale régionale, la gouvernance portuaire solide et le contrôle souverain de l’économie bleue résonne fortement avec les impératifs continentaux plus larges évoqués ici. Ce sont de telles contributions qui doivent passer des tribunes éditoriales aux salles de décision.
De plus, l’Afrique doit investir de toute urgence dans la surveillance côtière, les centres de fusion du renseignement maritime et les capacités de commandement naval. La sécurité maritime ne consiste pas seulement à défendre les eaux : il s’agit de contrôler les flux de marchandises, de données, d’énergie et d’influence. Dans ce domaine, le contrôle est la stratégie.
L’Afrique a pleinement le droit d’être une puissance maritime déterminante. Mais un droit non revendiqué est un droit non réalisé.
Les lignes bougent dans les affaires maritimes mondiales. L’Afrique ne peut plus se permettre d’être vue comme un simple couloir d’extraction ou un problème à résoudre. Nous sommes un continent stratégique. Nos eaux ne sont pas des corridors, ce sont des postes de commandement. Il est temps de les gouverner comme tels.
Abdisaid M. Ali est président du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et ancien conseiller à la sécurité nationale de la Somalie.
Source : ZWYA /The East African