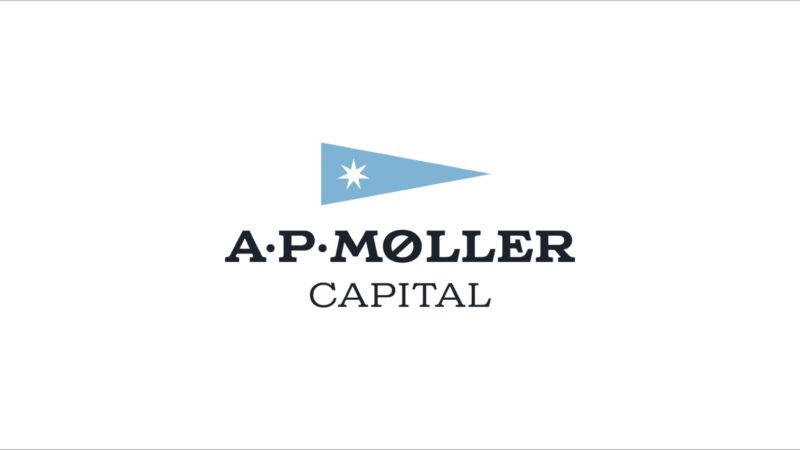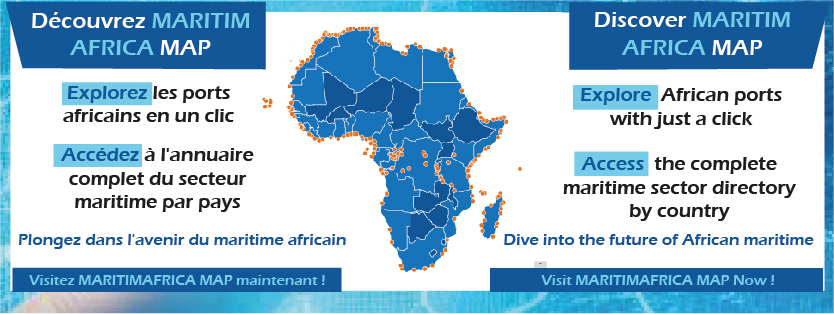Mode crise : les nouvelles stratégies de l’Afrique du Sud face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement

Plus de 47 milliards de rands (2,5 milliards de dollars) d’exportations sud-africaines vers les États-Unis, principalement d’acier et d’aluminium, sont menacés par une possible réintroduction des droits de douane de la section 232.
La crise n’est plus une exception : c’est devenu le mode par défaut du commerce mondial. Entre les chocs pandémiques, les blocages portuaires, les tensions géopolitiques et les revirements tarifaires, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont soumises à des pressions inédites.
Pour l’Afrique du Sud, le dernier bouleversement — une décision de justice américaine relançant l’incertitude tarifaire — est bien plus qu’un simple accroc. C’est un signal d’alarme rouge : le pays doit cesser de réagir a posteriori et commencer à repenser en profondeur ses approvisionnements, ses partenariats et sa capacité d’anticipation. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement les exportations, mais la résilience économique — et la survie.
La décision d’annuler les droits de douane dits « réciproques » instaurés par l’ex-président Donald Trump a semé la confusion parmi les importateurs mondiaux, fait flamber les tarifs de fret et ravivé les craintes de congestion sur les grandes routes maritimes.
Selon PwC, plus de 47 milliards de rands (2,5 milliards de dollars) d’exportations sud-africaines vers les États-Unis — principalement de l’acier et de l’aluminium — sont menacés par une éventuelle réinstauration des droits de douane au titre de la section 232.
Si ces droits sont réintroduits, les exportations sud-africaines vers les États-Unis pourraient chuter jusqu’à 35 % dans les secteurs clés, entraînant des effets en cascade : contraction des chaînes d’approvisionnement, pertes d’emplois et hausse des coûts opérationnels liés aux contournements logistiques et à la complexité réglementaire.
Une chaîne d’approvisionnement sous tension
« Le risque géopolitique n’est plus théorique. Il est immédiat, concret, et intégré dans la conception même de nos chaînes d’approvisionnement », explique Paul Vos, directeur régional pour l’Afrique australe de l’Institut agréé des achats et de l’approvisionnement (CIPS).
« Les entreprises sud-africaines doivent se demander non seulement comment réagir, mais aussi comment intégrer la résilience à chaque étage de leur stratégie d’approvisionnement, de manière proactive. »
Les signes avant-coureurs sont déjà visibles. Les tarifs mondiaux de fret maritime ont fortement augmenté ces dernières semaines : l’indice de fret conteneurisé de Shanghai a grimpé de 487 points et le World Container Index de Drewry a bondi de plus de 10 %, atteignant 2 508 dollars pour un conteneur de 40 pieds. Cette hausse est due à l’afflux de cargaisons à destination des États-Unis avant l’éventuelle application des nouveaux droits, qui a réduit la capacité sur les grandes routes et provoqué un retour de services maritimes, avec des retards de conteneurs à la clé.
Sur le plan national, les ports sud-africains sont mis à rude épreuve, tant en raison des volumes que de leur fragilité. Rien qu’au cours de la dernière semaine de mai, plus de 84 000 conteneurs (EVP) ont transité par les ports du pays, soit une hausse de 17 % par rapport à la semaine précédente — malgré les intempéries, les pannes d’équipements et les pénuries de personnel.
Les flux commerciaux transfrontaliers sont également sous pression. Les retards aux frontières et les files d’attente coûteraient au secteur du transport environ 168 millions de rands par semaine, selon la dernière mise à jour conjointe de Business Unity South Africa (Busa) et de l’Association sud-africaine des transitaires (Saaff).
L’approvisionnement, moteur de la transformation
Paul Vos estime que les leçons des crises passées — Covid-19, guerre en Ukraine, insécurité maritime en mer Rouge — ne doivent plus être perçues comme des événements ponctuels.
« Ces événements révèlent tous la fragilité systémique des réseaux d’approvisionnement mondiaux. Pour l’Afrique du Sud, la résilience doit devenir une priorité nationale, pas une réflexion de dernière minute en conseil d’administration. »
Des progrès ont été réalisés depuis la pandémie, notamment en matière de diversification des fournisseurs et de relocalisation.
Les grandes entreprises ont montré la voie, en investissant dans le développement de fournisseurs locaux et en rapatriant certaines activités. Mais Vos avertit que cette évolution est encore trop hétérogène et souvent guidée par la conformité, non par une véritable stratégie. « Ce que l’on voit souvent, c’est une localisation dictée par des obligations réglementaires, sans réelle recherche d’avantage compétitif. Pour localiser efficacement, il faut des écosystèmes d’approvisionnement : infrastructures, accès aux marchés, développement des compétences, et demande soutenue. »
Il plaide pour un rôle moteur de la fonction achats dans la redéfinition de l’évaluation et de la gestion des risques. Cela passe par une visibilité approfondie, au-delà des fournisseurs de premier rang, jusqu’aux niveaux 2 et 3. Tours de contrôle numériques, planification de scénarios, analyse des risques par IA, systèmes d’alerte géopolitique en temps réel — ces outils deviennent la norme dans les chaînes résilientes.
Mais ces outils ne valent que par la qualité des données, la gouvernance et les compétences humaines qui les accompagnent, rappelle-t-il.
Autre levier essentiel : redéfinir la notion de valeur. Vos estime que les équipes achats doivent dépasser la recherche du prix le plus bas.
« Efficacité et résilience ne sont pas opposées. La compétitivité à long terme repose sur une approche coût total de possession, qui intègre le risque, la durabilité, la santé des fournisseurs et les performances ESG. » Il recommande des modèles à double sourcing, des stocks tampons pour les intrants critiques, et des partenariats renforcés avec les fournisseurs comme leviers concrets à activer en cas de crise.
Se préparer aux prochaines perturbations
L’État a aussi un rôle clé à jouer. Vos appelle à la mise en place de cadres politiques nationaux favorisant les incitations industrielles, la cohérence réglementaire et la modernisation des infrastructures logistiques. Mais surtout, il prône une collaboration public-privé pour impulser le changement : « plateformes sectorielles d’achats, programmes partagés de développement fournisseurs, responsabilité conjointe en matière d’emplois et de compétences — voilà les mécanismes de la vraie résilience. »
La professionnalisation de la fonction achats sera aussi essentielle. Des qualifications comme le MCIPS dotent les praticiens d’un socle éthique, d’une vision stratégique et d’outils de gestion des risques adaptés aux contextes complexes.
« La professionnalisation est le fondement de chaînes d’approvisionnement éthiques et performantes, notamment dans le secteur public, où les achats doivent être la première ligne de défense contre le gaspillage et la corruption », souligne Vos.
En regardant vers l’avenir, les entreprises sud-africaines doivent se préparer à des perturbations qui ne sont plus hypothétiques. Parmi elles : taxes carbone aux frontières, cybermenaces, instabilité politique, chocs climatiques, contraintes persistantes sur les infrastructures (énergie, transport, logistique).
Pour Vos, se prémunir, c’est anticiper, et agir dès maintenant.
L’avenir appartiendra à ceux qui sauront numériser, décentraliser et décarboner. « Pour prospérer dans l’incertitude – et non simplement y survivre – nous devons intégrer la résilience dans nos modes d’achat, de production et de partenariat. La prochaine crise n’est pas une question de “si”, mais de “quand”. »