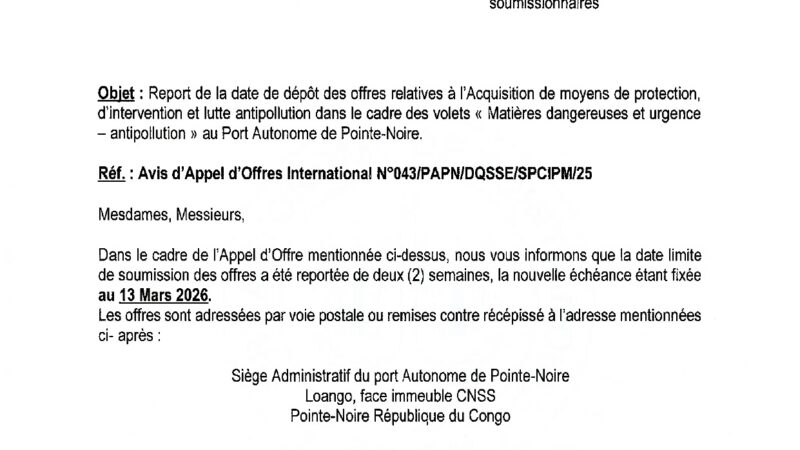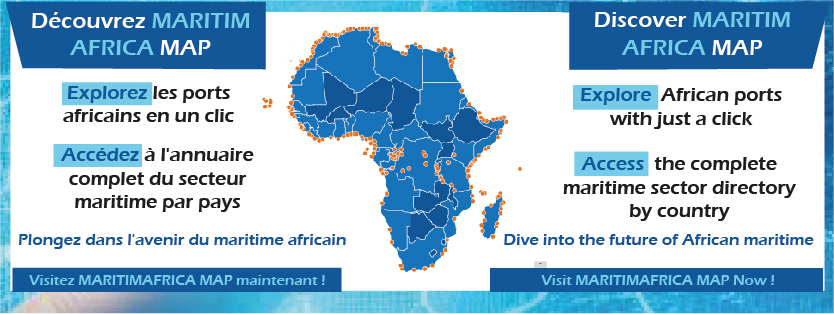Corridors de l’AES : une nouvelle rivalité avec les routes commerciales traditionnelles

Depuis leur retrait de la CEDEAO en 2024, les trois nations enclavées formant l’Alliance des États du Sahel (AES) – le Burkina Faso, le Mali et le Niger – cherchent à affirmer leur souveraineté. Représentant une population d’environ 77 millions d’habitants, l’importance de leurs échanges commerciaux demeure capitale pour les États côtiers d’Afrique de l’Ouest.
La récente instabilité politique dans les pays de l’AES a fragilisé les circuits commerciaux historiques, ouvrant la voie à l’émergence de nouveaux corridors logistiques qui remodèlent la dynamique du commerce régional. Les routes traditionnelles passaient principalement par les ports de Cotonou, Lomé, Abidjan et Dakar.
Les Corridors Historiques en Mutation
Dakar (Sénégal) : Une Position Dominante Bâillonée
Historiquement, le port de Dakar a servi de principal accès maritime pour le Mali, gérant 70 à 80 % de ses importations et exportations, ce qui représentait près de 1 700 milliards de FCFA pour le Sénégal avant les récents troubles politiques. Le corridor Dakar-Bamako maintient un flux important de camions quotidiens.
Le Sénégal a investi dans la modernisation avec la plateforme numérique GUICHET UNIQUE D’ENLÈVEMENT PORTUAIRE (GUEP), réduisant les délais de traitement de 40 %. Le futur port de Ndayane, avec sa vision de dématérialisation totale, des temps de passage inférieurs à 24 heures et une gestion assistée par l’IA, est destiné à consolider la place du Sénégal comme plateforme logistique régionale. Un port sec prévu à Sandiara (à 100 km de Dakar) doit rapprocher les services du Mali.
Cependant, les sanctions régionales imposées par la CEDEAO et l’UEMOA ont fait chuter le trafic malien de 7,6 %, déplaçant une partie des flux vers Nouakchott, Conakry ou Abidjan.
Abidjan (Côte d’Ivoire) : Modernisation et Incitations Commerciales
Avec un trafic de près de 34,8 millions de tonnes en 2023, le Port Autonome d’Abidjan (PAA) est incontournable en Afrique de l’Ouest. Au premier semestre 2023, le trafic en transit vers l’AES représentait 8,5 % du volume total, soit plus de 2 millions de tonnes.
Malgré une baisse de trafic d’environ 6 % due à l’insécurité et à l’embargo nigérien, Abidjan reste attractif grâce à un réseau routier et ferroviaire développé. La ligne ferroviaire Abidjan-Ouagadougou (1 145 km) assure le transport d’environ 900 000 tonnes de fret annuellement vers le Burkina Faso. Le projet de port sec de Ferkessédougou vise également à servir les opérateurs burkinabè et maliens.
Le PAA investit massivement (34 quais, terminaux spécialisés, 900 000 m² d’entrepôts). Des acteurs privés comme Africa Global Logistique (AGL) prévoient d’investir plus de 60 millions d’euros pour créer des hubs (entrepôts froids, plateformes régionales) à Ferkessédougou, Bouaké et San Pedro.
Abidjan met en œuvre des mesures incitatives, telles que des réductions tarifaires de 30 % sur les redevances portuaires pour le transit en vrac et des exonérations fiscales ciblées, pour attirer le trafic de l’AES. Malgré ces efforts, l’expansion du port est limitée par la densité urbaine et il doit faire face à la concurrence, notamment du corridor guinéen.
L’Émergence de Nouveaux Compétiteurs
Conakry (Guinée) : Le Levier de la Proximité et des Sanctions
Bien que Conakry soit géographiquement plus proche de Bamako (991 km) que Dakar ou Abidjan, le Port Autonome de Conakry (PAC) ne gérait initialement que moins de 5 % du trafic malien. L’embargo de la CEDEAO en 2022 a cependant permis au PAC de capter jusqu’à 20 % du trafic malien.
La Guinée a mis en place des facilités tarifaires agressives (réduction de 50 % sur les redevances en vrac, franchise de 21 jours, exonération de TVA) et a rationalisé les formalités douanières (réduites de 7 à 2 jours). Un protocole de coopération a également été établi pour le corridor Conakry-Ouagadougou, avec l’ouverture d’un bureau de liaison burkinabè envisagée au port. Le corridor routier Conakry-Bamako est réputé en bon état et peu sujet aux tracasseries.
Cependant, le coût maritime élevé des marchandises à destination de Conakry (jusqu’à 1 000 USD de plus par conteneur par rapport à Dakar ou Lomé) demeure un frein majeur, limitant l’utilisation de ce corridor par le Mali, le Burkina et le Niger.
Lomé (Togo) : Neutralité et Infrastructure de Pointe
Régulièrement classé parmi les 100 premiers ports mondiaux de conteneurs, le Port Autonome de Lomé (PAL) est un partenaire historique. En 2022, les pays de l’AES représentaient plus de 92 % du volume de transit du PAL, avec une prédominance du Burkina Faso (80,48 %).
Lomé investit en continu : un tirant d’eau naturel de 16 mètres pour accueillir les plus grands navires, des plateformes de digitalisation (paiement et documents en ligne), la suppression des multiples contrôles routiers et l’interconnexion douanière avec les pays de l’AES. Le PAL mène des missions de promotion actives et travaille en étroite collaboration avec l’Office Togolais des Recettes (OTR) pour fluidifier les corridors et réduire les délais.
Malgré des distances routières parfois plus longues, le PAL consolide son rôle grâce à sa neutralité diplomatique (médiateur AES/CEDEAO) et à ses infrastructures modernes.
L’Initiative Atlantique du Maroc : Un Géant en Préparation
Face aux incertitudes régionales, les pays de l’AES diversifient leurs options. Le Maroc, fort de son expertise logistique, propose le mégaprojet Port Atlantique de Dakhla, lancé en 2021. Cette « Initiative Royale Atlantique pour le Sahel » vise à offrir un accès direct à l’Atlantique aux pays enclavés du Sahel.
Prévu pour être opérationnel en 2028-2029, le port aura une capacité de 35 millions de tonnes/an. Un investissement de 1,3 milliard de dollars prévoit de relier Dakhla au Sahel via des corridors multimodaux (routes et rail) traversant la Mauritanie vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Si ce corridor devient pleinement fonctionnel, il pourrait réduire de 20 à 30 % les coûts et délais d’import/export.
Conclusion : Une Compétition Bénéfique
La quête de l’AES pour réduire sa dépendance aux corridors traditionnels (Dakar, Abidjan, Lomé, Cotonou) a ouvert une compétition féroce, favorisant l’émergence de nouvelles routes (Conakry, Nouakchott, et bientôt Dakhla). Cette « bataille des corridors » est potentiellement bénéfique pour les populations de l’AES, car elle pourrait entraîner une réduction des coûts d’acquisition des biens importés et une meilleure valorisation des exportations sur le marché mondial.