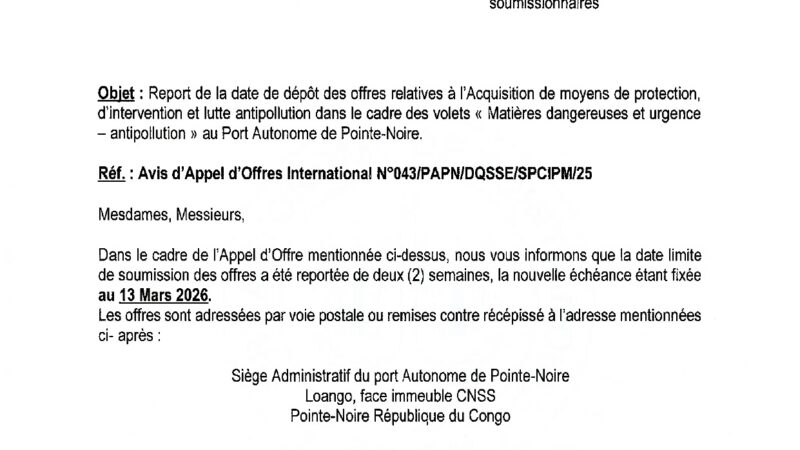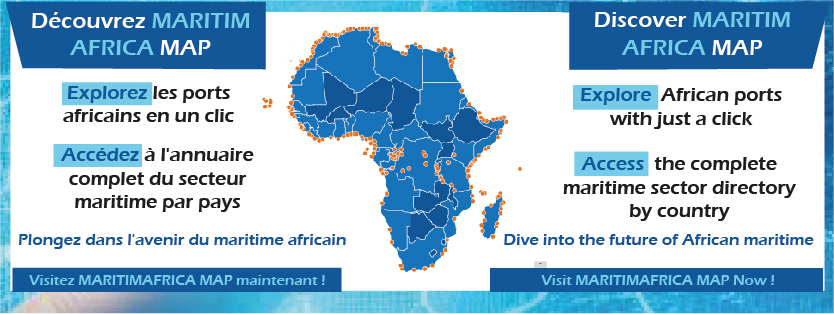Repenser les corridors commerciaux de l’Afrique : un plan directeur pour l’intégration, la croissance et la résilience

Les pays africains peuvent libérer toute la valeur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et permettre aux commerçants — en particulier les petites entreprises — de participer au commerce transfrontalier en toute confiance.
Alors que la dynamique du commerce mondial évolue et que la gravité économique s’oriente de plus en plus vers le Sud global, l’Afrique se trouve à un moment charnière. Abritant 1,4 milliard d’habitants et riche en ressources naturelles, le continent ne contribue pourtant qu’à moins de 3 % du commerce et du PIB mondiaux, bien qu’il représente 17 % de la population de la planète. Ce déséquilibre souligne l’urgence de transformer le paysage commercial africain.
Lancée le 1er janvier 2021, la ZLECAf constitue une opportunité historique d’unifier les marchés et de stimuler le commerce intra-africain, qui pourrait passer de 16 % aujourd’hui à plus de 50 %, à l’image de l’Union européenne et de l’Asie.
« Mais réaliser cette promesse exige plus que de l’ambition ou des accords commerciaux. Il faut repenser et reconstruire les artères du commerce africain : ses corridors commerciaux. Au-delà des voies ferrées, des routes et des ports, ces corridors doivent devenir des écosystèmes intégrés soutenant l’industrialisation, le commerce numérique, la croissance verte et la résilience face aux chocs mondiaux », explique Sheetal Kumar, responsable de la couverture clientèle, banque d’entreprises et institutionnelle.
Le défi hérité : des corridors coloniaux à l’ère moderne
Les corridors commerciaux existants en Afrique, tels que le corridor côtier Abidjan–Lagos, le corridor du Nord (Mombasa) ou le corridor central (Dar es Salaam), ont été conçus à l’époque coloniale pour extraire les ressources plutôt que pour favoriser l’intégration régionale. Résultat : le commerce intra-africain demeure obstinément faible.
Les coûts commerciaux figurent parmi les plus élevés au monde — jusqu’à 283 % de la valeur des biens, selon la Banque mondiale — en raison des infrastructures déficientes, des lenteurs aux frontières et de réglementations mal harmonisées.
Malgré des progrès récents, le commerce intra-africain a atteint 208 milliards USD en 2024 (soit une hausse de 7,7 % sur un an), mais seule une fraction de ce volume reste sur le continent. En comparaison, plus de 60 % du commerce en Asie et 70 % dans l’UE sont réalisés en interne : un écart qui révèle une immense opportunité.
Combler cet écart suppose de réinventer les corridors pour plus de rapidité, de fiabilité et de résilience. Par exemple, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique prévoit une hausse de 28 % des volumes de fret intra-africains d’ici 2030, nécessitant la modernisation de plus de 60 000 km de routes stratégiques.
Des corridors stratégiques dans un monde fragmenté
Le phénomène de fragmentation géoéconomique — où les pays restructurent leurs échanges autour de blocs politiques — représente un nouveau risque pour l’Afrique. Jusqu’à la moitié du commerce extérieur du continent serait vulnérable à ce scénario, entraînant une baisse potentielle du PIB de 4 % sur dix ans. Les tensions politiques et les différends régionaux compromettent également les objectifs d’intégration de la ZLECAf.
Face à cela, l’Afrique doit adopter une approche audacieuse mais pragmatique :
- Stratégie de connecteur : Les corridors doivent servir de ponts entre blocs géopolitiques — à l’image du rôle du Vietnam ou du Mexique dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les banques peuvent structurer ces corridors en plaques tournantes reliant les blocs Est et Ouest, offrant des zones tampons face aux chocs géopolitiques.
- Clusters de corridors : Aligner les corridors régionaux sur des bassins d’investisseurs variés pour se protéger des risques géopolitiques. Les structures de financement peuvent diversifier les sources de capitaux à travers différents blocs.
- Atténuation des risques : Recourir à des assurances contre les risques politiques, à des garanties commerciales et à des financements alternatifs pour pallier les perturbations.
Des institutions financières comme Bank One jouent un rôle essentiel dans la structuration de ces modèles, protégeant les corridors des incertitudes mondiales tout en favorisant une croissance régionale inclusive.
Des accords commerciaux aux autoroutes du commerce
La ZLECAf vise à éliminer les droits de douane sur 97 % des produits et à doubler le commerce intra-africain d’ici 2035. Mais pour concrétiser ce potentiel, il faut des corridors opérationnels.
Des ports comme Berbera au Somaliland — où DP World a investi 442 millions USD — illustrent ce qu’il est possible d’accomplir lorsque infrastructures, politiques et capitaux s’alignent. De même, l’extension du terminal à conteneurs de Maputo (165 millions USD) doublera sa capacité et en fera un nœud stratégique entre l’Afrique australe et le Golfe.
Ces initiatives ne sont pas de simples projets : ce sont des modèles reproductibles. Le développement des corridors doit intégrer :
- Transports multimodaux : interconnexion fluide du rail, de la route, de l’air et des ports ;
- Clusters industriels : adosser les corridors à des pôles de fabrication, d’agro-industrie ou de services ;
- Plateformes numériques : logistique intelligente, e-douanes, blockchain et IoT pour la traçabilité en temps réel ;
- Infrastructures vertes : transport électrique, matériaux résilients et financements liés au carbone.
Des exemples comme le corridor du Lobito ou la ligne Tanzanie–Zambie montrent le potentiel multimodal de ces projets. Associés à des plateformes logistiques intérieures, des ports secs et des zones économiques spéciales, ils deviennent de véritables moteurs de création de valeur régionale.
La digitalisation : moteur du commerce en temps réel
La transformation numérique constitue le système nerveux du commerce africain de demain. Les initiatives reliant les systèmes douaniers, de paiement et de logistique peuvent supprimer les goulets d’étranglement et renforcer la conformité.
Les partenariats entre fintechs africaines et entreprises technologiques du Golfe ont déjà permis des projets pilotes de suivi en temps réel des cargaisons, de dédouanement intelligent et d’authentification blockchain.
Maurice, en tant que pôle financier et numérique émergent, joue un rôle de pionnier. Les banques y développent :
- des plateformes de financement du commerce numérique transfrontalier ;
- des offres bancaires digitales destinées aux PME ;
- des systèmes de paiement intégrés adaptés à des marchés régionaux fragmentés.
En généralisant ces outils, les nations africaines pourront libérer tout le potentiel de la ZLECAf et donner aux entrepreneurs — notamment les petites entreprises — les moyens d’échanger au-delà des frontières en toute confiance.
Les corridors verts : durabilité et résilience
Le changement climatique perturbe de plus en plus les transports — qu’il s’agisse d’inondations en Afrique de l’Ouest ou de routes endommagées par la chaleur en Afrique de l’Est. L’Afrique ne peut se permettre des infrastructures vulnérables aux aléas climatiques.
Les corridors verts ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Cela implique :
- des systèmes de transport et de fret électriques ;
- des centres logistiques alimentés par l’énergie solaire ;
- des ponts résistants aux inondations et des routes adaptées au climat ;
- des obligations vertes et des financements mixtes liés au climat.
Des banques comme Bank One mobilisent des financements alignés sur les critères ESG, des obligations vertes et des prêts respectueux du climat pour soutenir des projets d’infrastructures durables. Ces corridors écologiques permettent aussi de réduire les risques pour les investisseurs en s’alignant sur les normes mondiales de durabilité.
Le nexus Afrique–Moyen-Orient : un partenariat en plein essor
Le Moyen-Orient s’impose comme un partenaire stratégique et financier majeur. Des acteurs tels que DP World ou les fonds souverains du Golfe injectent des milliards dans les ports, les énergies renouvelables et les infrastructures logistiques africaines.
Entre 2019 et 2023, les entités émiraties ont investi 110 milliards USD dans des projets africains, dont 72 milliards consacrés aux énergies renouvelables. DP World prévoit d’ajouter encore 3 milliards USD d’ici 2029 pour les infrastructures commerciales africaines.
Les institutions financières à portée régionale sont idéalement placées pour accompagner cet axe croissant, en proposant :
- des produits financiers conformes à la charia ;
- des services de correspondance bancaire sur les corridors Afrique–Moyen-Orient ;
- des solutions de financement commercial multidevises adaptées aux investisseurs du Golfe.
L’environnement réglementaire mauricien, ses conventions de non-double imposition et sa position géographique stratégique font de Bank One une plateforme de confiance pour les flux d’investissements entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie.
Financer le rêve : l’innovation plutôt que l’aide
Le financement public traditionnel ne suffira pas. Mobiliser le capital exigera :
- des modèles de financement mixte combinant fonds de développement, capitaux privés et agences de crédit à l’exportation ;
- des prêts syndiqués dirigés par des banques régionales et des institutions financières de développement ;
- des taux indexés sur les performances, liés à des objectifs climatiques ou logistiques ;
- des partenariats public–privé fondés sur une gouvernance claire et un partage transparent des risques.
La compréhension des contextes locaux reste déterminante. Bank One tire parti du soutien de ses actionnaires solides — le groupe I&M en Afrique de l’Est et le groupe CIEL à Maurice — pour concevoir des solutions bancables et évolutives dédiées au développement des corridors africains.
Le dividende humain : politiques, PME et jeunesse
Des infrastructures sans développement humain n’ont pas de sens. Le véritable succès d’un corridor se mesure à son impact sur les vies humaines.
- Harmonisation des politiques : l’alignement réglementaire est crucial et doit servir les intérêts communs des populations, au-delà des considérations politiques. Les règles de la ZLECAf doivent s’appliquer uniformément le long des corridors pour le bénéfice des commerçants africains.
- Autonomisation des PME : le commerce doit inclure les acteurs informels, les entreprises dirigées par des femmes et les jeunes entrepreneurs. Les usines, mines, fermes et pôles de services africains doivent pouvoir accéder réellement aux marchés, du Caire au Cap, de Lagos au Golfe.
- Développement des compétences : les corridors doivent créer des emplois non seulement dans la construction, mais aussi dans la logistique, la fintech, l’agro-industrie et les services. Chaque point de gain en efficacité représente des millions de dollars de PIB et des dizaines de milliers d’emplois.
D’Addis-Abeba à Accra, de Port-Louis à Port-Harcourt, de Nairobi à Nouakchott, de Dar es Salaam à Dakar, du Cap au Caire, de Luanda à Lagos, de Mombasa à Maputo, de Gaborone à Gizeh jusqu’au Golfe, des corridors efficaces peuvent devenir de véritables lignes de vie : réduire l’émigration, accroître les revenus et élargir les perspectives.
Cela reflète la mission essentielle de Bank One : « Favoriser votre prospérité ».
De la fragmentation à la fusion : des routes vers la prospérité
Les corridors commerciaux africains ne doivent pas être les victimes d’un monde fragmenté ; ils doivent s’élever au-dessus de cette division.
En construisant des corridors flexibles, numérisés, verts et stratégiquement alignés, et en les finançant par des modèles innovants et inclusifs, l’Afrique peut inaugurer une nouvelle ère de croissance tirée par le commerce.
Les corridors ne sont plus seulement des voies de transport ; ils sont des vecteurs de transformation.
Avec des banques comme Bank One en architectes financiers, Maurice comme passerelle et la ZLECAf comme plan directeur, l’Afrique dispose de tous les atouts pour réinventer son avenir.
Faisons circuler, non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des investissements et de l’espoir, le long des routes menant à une prospérité partagée.